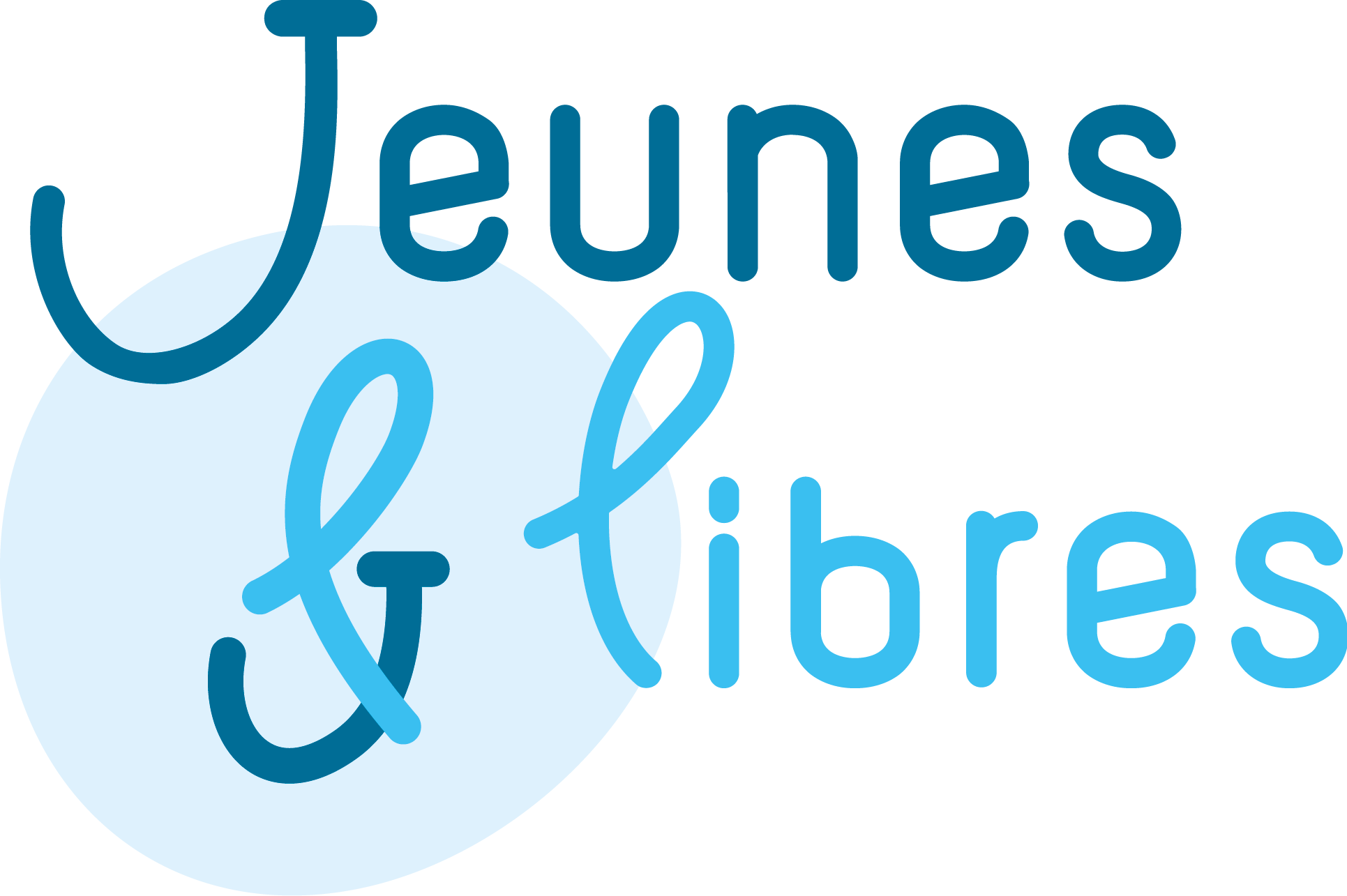Ayant débuté sa carrière politique en 2018 en devenant présidente du conseil communal de Verviers, Stéphanie Cortisse est députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2019. Particulièrement investie dans son mandat, la députée a accepté de répondre à quelques questions de Jeunes & Libres concernant l’Enseignement au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Jeunes & Libres : Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, pouvez-vous résumer vos parcours professionnel et politique ?
Stéphanie Cortisse : J’ai suivi un cursus en droit à l’Université de Liège et je suis devenue par la suite avocate en 2011. J’ai toutefois mis ma carrière professionnelle de côté depuis 2019 pour me consacrer entièrement à mes mandats politiques, celui de présidente du conseil communal de Verviers depuis 2018 et celui de députée communautaire depuis l’année suivante.
J&L : Quelles sont les matières que vous suivez particulièrement en tant que députée communautaire ?
S. C. : Étant donné que je ne suis députée qu’au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (l’arrondissement de Verviers compte une partie francophone et une partie germanophone. Or un élu qui prête serment en allemand, en l’occurrence la députée Christine Mauel, à la Région wallonne ne peut pas siéger à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est donc sa suppléante, Stéphanie Cortisse, qui l’y remplace, mais uniquement au parlement communautaire, NDLR), j’ai voulu m’investir dans une des matières les plus importantes de la Fédération, c’est-à-dire l’Éducation. Je suis ainsi membre effective de la Commission de l’Enseignement obligatoire, mais aussi membre suppléante de la Commission liée aux compétences de Valérie Glatigny, dont l’Enseignement supérieur notamment, mais aussi la Jeunesse et le Sport. Je travaille par ailleurs sur les questions relatives à la Petite Enfance (dont l’accueil temps libre et les crèches) au sein de la Commission de l’Enfance.
J&L : Avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter votre “modèle idéal” de l’École ?
S. C. : Ce serait un modèle où chaque élève trouve sa voie positivement. Il faut bien évidemment une maîtrise des compétences de base, notamment en mathématiques et en français. Ces connaissances doivent être acquises pour tous les élèves au sortir du tronc commun. Mais une fois que l’on sort de ce tronc commun, je pense qu’il faut vraiment une orientation beaucoup plus positive. Je fais ici référence à l’enseignement qualifiant qui est devenu, dans bien des cas, une filière de relégation. Il faut le revaloriser ainsi que l’enseignement en alternance. Notre Ministre-Président, Pierre-Yves Jeholet, y travaille, car c’est une compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ce qui relève de l’enseignement, mais cela relève aussi des compétences régionales pour ce qui est de la formation en alternance. Il faut plus de synergies entre la Fédération et les Régions et rationaliser les moyens.
L’idée est de rendre l’enseignement en alternance plus lisible et plus attractif pour les jeunes. Lorsque la réforme du tronc commun aura été achevée, il ne restera que deux filières, la filière de transition et la filière qualifiante. Plusieurs pistes sont mises sur la table par le Mouvement Réformateur pour travailler cette lisibilité et cet attrait. Par exemple, la mise en place de semaines d’activités orientantes à la fin du tronc commun, en 3e année secondaire. Cette mesure ne figurait pas dans le Pacte d’Excellence, mais nous avons réussi à l’inscrire dans la déclaration de politique communautaire quand le gouvernement s’est mis en place. Ensuite, j’ai personnellement fait une proposition pour établir un test d’orientation non contraignant et volontaire, également à la fin de la 3e année secondaire. Enfin, il est nécessaire de mettre en avant les “filières en pénurie”, les formations qui sont porteuses de débouchés, d’emplois et de sens. C’est là une des propositions typiquement libérales.
Concernant le test d’orientation, la Ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, travaille sur un dispositif à destination des élèves de rhétorique pour une meilleure orientation en vue des études supérieures, car, à l’heure actuelle, entre 50% et 60% des étudiants abandonnent, doublent ou se réorientent à la fin de leur première année d’étude. Une partie du problème réside dans un mauvais choix d’orientation. Ce test, non contraignant, devrait être mis en place lors de la prochaine année académique et ensuite être amélioré au fur et à mesure.
À mon sens, quelle que soit la filière suivie, cela ne devrait pas empêcher d’obtenir le CESS à la fin des études secondaires et de pouvoir entamer des études supérieures pour ceux qui le souhaitent.
J&L : Si l’on souhaite que tous les élèves puissent obtenir le CESS à l’issue de leurs études secondaires, ne faut-il pas maintenir le tronc commun jusqu’à la fin et ne pas faire de différenciation ?
S. C. : Non, car dans la filière qualifiante, nous retrouverions les cours pratiques, techniques, mais également les cours généraux, théoriques, qui permettent d’obtenir le CESS pour ceux qui le souhaitent. Il s’agirait d’une possibilité et non d’une obligation pour terminer ses études secondaires.

J&L : Est-ce que l’École doit s’occuper d’éducation ?
S. C. : Aujourd’hui, la Ministre en charge des écoles ne s’appelle plus Ministre de l’Enseignement, mais Ministre de l’Éducation. Je trouve que cela n’est pas anodin du tout. Je constate sur le terrain que l’on en demande de plus en plus aux écoles. Je vais développer deux exemples.
De plus en plus d’enfants entrent à l’école maternelle ne sachant toujours pas être “propres”. Bien entendu, un accident peut toujours arriver ou certains enfants mettent plus de temps à acquérir ces réflexes, mais il existe une tendance qui ne va qu’en augmentant et le personnel enseignant ne se l’explique pas. S’agit-il d’une évolution de la société ? Les parents ont-ils de moins en moins le temps d’éduquer ? En définitive, ce changement oblige les enseignants à s’occuper de ces enfants au détriment des apprentissages et du groupe. Désormais, beaucoup d’écoles disposent d’une puéricultrice en plus de l’enseignant maternel. L’École doit ainsi pallier une “mission” qui est normalement dévolue aux parents.
Un deuxième exemple qui provient directement de mes rencontres de terrain concerne la politesse, et ce, à tout âge. Les enseignants se voient obliger d’inculquer des règles éducationnelles qui s’apprennent normalement à la maison.
Ces deux exemples démontrent que ce qu’on peut appeler “l’éducation à l’école” déresponsabilise les parents. Cela renforce à nouveau la pénurie d’enseignants. Une partie d’entre eux ne se retrouvent plus dans leur métier, ils veulent faire plus de pédagogie et on leur demande d’autres tâches.
J&L : Comment faites-vous pour vous tenir au courant des réalités de l’école?
S. C. : Les députés et les ministres font souvent des visites de terrain. Dans mon cas et parce que je me consacre à plein temps à mon mandat, j’ai décidé de faire systématiquement le tour de toutes les écoles de mon arrondissement. Cela représente environ 160 établissements, tous réseaux confondus, du communal à Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) en passant par le provincial, le réseau libre, donc souvent catholique, de la maternelle à la secondaire, de l’enseignement ordinaire à l’enseignement spécialisé, du monde rural aux villes. C’est un travail qui est très apprécié parce que je prends le temps de rencontrer chaque direction. Malheureusement, je n’ai souvent pas le temps de rencontrer tous les enseignants et eux non plus car ils sont en classe, mais je prends le temps de rencontrer ceux qui me le demandent. Je prépare ces moments de rencontre et de nombreuses thématiques liées à l’École et aux reformes que l’on mène notamment avec le Pacte d’Excellence sont abordées.
Je compte produire un rapport en fin de mandature sur les grandes tendances de l’enseignement au sein de l’arrondissement de Verviers. J’espère que ce rapport sera valorisable pour l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu’il servira, avant tout, de base à la construction de notre programme en vue des prochaines élections et plus si nous sommes en charge de l’Enseignement durant la prochaine législature.
Avant cela, ces témoignages me servent d’ores et déjà pour mon travail parlementaire, lors de rencontres ou au moment de poser des questions en commission.
J&L : Pouvez-vous nous faire déjà part de grandes tendances que vous avez pu observer ?
S. C. : Beaucoup de sujets sont traités, mais je citerais en premier lieu le lien entre l’indice socio-économique d’une école qui est plus élevé et “l’ingérence” de certains parents, notamment dans les questions pédagogiques. Cela entraîne une dévalorisation du travail des enseignants.
On retrouve moins ce phénomène dans les établissements où l’indice est moins élevé et où les parents sont par contre davantage “démissionnaires”, ce qui est également problématique. Il n’y a pas de généralisation, mais il s’agit néanmoins d’une tendance lourde. Ils ne viennent même pas, par exemple, aux réunions de parents et à nouveau, les enseignants sont assez désemparés parce qu’ils aimeraient pouvoir discuter avec les parents des difficultés des élèves.
Une autre tendance est qu’aucune, je dis bien aucune, direction ne me dit que l’allongement du tronc commun est une bonne chose…
J&L : Qu’attendez-vous du Pacte d’Excellence ?
S. C. : Le Pacte d’Excellence part de constats, notamment des tests PISA. Ces tests sont réalisés dans les 50 pays de l’OCDE. Nous constatons que malgré le financement élevé de l’Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, même plus élevé que dans la plupart des autres pays, nous avons les moins bons résultats. Nous avons un taux élevé de redoublement et un taux élevé d’abandon scolaire. Partant de cela, il a fallu une grande réforme dont les travaux ont été entamés en 2015, période durant laquelle les libéraux n’étaient pas encore au pouvoir en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Pacte s’est ensuite concrétisé en 2017, après des concertations sur lesquelles nous reviendrons. Le but de ce pacte est de transcender les mandatures et d’éviter qu’à chaque changement de majorité, on ne le remette en cause. Pour nous, cela a toujours été clair. Nous allons respecter le pacte, du moins dans ses grandes lignes, en y apportant notre touche. Le Ministre-Président Jeholet l’a rappelé au début de la mandature : « le Pacte n’est pas une Bible, mais une feuille de route ». Pour chaque réforme prévue dans le Pacte, les libéraux vont implanter leurs marqueurs.
Quant aux résultats, ils ne seront pas visibles tout de suite. Les principales mesures sont seulement entrées en vigueur cette année en 1re et 2e années primaires et l’année prochaine, en 3e et 4e et ainsi de suite. Les années secondaires ne seront concernées qu’à partir de 2026 seulement.
Plusieurs mesures vont dans le bon sens pour moi. Outre un renforcement de l’accompagnement personnalisé pour les élèves en difficulté, le fait d’avoir créé un tronc commun “polytechnique et pluridisciplinaire” permet à l’élève de “toucher un peu à tout” durant une grande partie de sa scolarité. Je pense notamment au nouveau cours “FMTTN” (Formation Manuelle Technique Technologique et Numérique) qui offrira déjà une possibilité d’orientation. Je peux également citer le renforcement de l’apprentissage des langues modernes avec l’éveil aux langues dès la 1re maternelle, l’apprentissage d’une langue moderne en 3e année primaire (au lieu de la 5e) dès l’année prochaine et ensuite l’apprentissage d’une deuxième langue dès la 2e année secondaire (au lieu de la 3e).
Nous serons toutefois attentifs à ce que les nouveaux cours ne déforcent pas les apprentissages de base que sont le français et les mathématiques et à ne pas “niveler par le bas”.

J&L : Vous parliez tout à l’heure de l’accueil qui est fait au tronc commun dans les écoles que vous avez visitées…
S. C. : Plus précisément à son allongement. Le tronc commun en soi est une bonne idée, il permet une continuité dans les apprentissages à travers toutes les écoles. Néanmoins, l’allongement jusqu’à 15 ans est problématique sachant qu’à l’épreuve certificative CE1D, en fin de 2e année secondaire, le taux d’échec est de 50%. En reportant cette épreuve à la fin de la 3e année secondaire, on aura obligé des jeunes à suivre une année de plus des cours “généraux” alors qu’ils seraient probablement mieux orientés vers le qualifiant. N’y aura-t-il dès lors pas encore plus de redoublement et de décrochage scolaire alors que le Pacte s’est donné au contraire l’ambition de diminuer de 50% le taux de décrochage scolaire et 50% le taux de redoublement d’ici 2030 ?
J&L : Quelle place doit occuper la Culture à l’École ?
S. C. : Je pense que la Culture a toute sa place à l’École. Jusqu’à présent, sa diffusion au sein des établissements était laissée au bon vouloir des équipes pédagogiques, surtout au sein des établissements les plus proactifs qui organisaient régulièrement des sorties et activités extrascolaires. Le nouveau Parcours d’Éducation Culturelle et Artistique (PECA) qui sera applicable à toutes les écoles permettra à tout le monde un même accès à la Culture.